ARTICLE
Prise chaude : une certaine idée du jeu japonais
Les journalistes ont été très nombreux, nous-mêmes compris, à raconter que le Japon vidéoludique n'a pas été au top de sa forme depuis maintenant quelques années déjà. Aujourd'hui, le discours à la mode est celui de la résurrection du jeu japonais ; mais pourquoi partir du principe qu'il était "mort" jusqu'à présent ?
"Prise chaude", ça veut dire "hot take" en langage Twitter. Plutôt que de réserver nos réflexions à ce réseau social inconfortable, nous avons préféré vous les partager ici, sans contrainte de forme. Ça ne va pas forcément quelque part, mais ça nous permet de déplacer le débat chez nous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez !
On a peut-être un petit problème avec le Japon.
Je conçois l’ironie de dire une chose pareille quelques
Contrairement à Game Next Door, une chaîne YouTube dont le contenu est habituellement fort intéressant, mais qui s’est un peu pris les pieds dans le tapis dans leur récent épisode intitulé “Le retour du jeu vidéo japonais”. Outre le fait que ce sujet est un authentique marronnier qui fascine les journalistes depuis que Keiji Inafune a lâché son fameux “Japan is over” au Tokyo Games Show 2009 (dans deux mois ça fera dix ans), la vidéo de GND s’englue dans des lieux communs et des confusions fâcheuses, en dépit des interventions des journalistes Oscar Lemaire et Daniel Andreyev, qui semblent eux-même peiner à trouver quelque chose de pertinent à dire. C’est que le sujet est plutôt casse-gueule, surtout si on ne précise pas de quoi on parle exactement quand on parle du “retour” du “jeu vidéo japonais”. Et les maladresses que commet l’épisode de GND sont déjà présentes dans la plupart des articles qui, avant lui, avaient tenté d’aborder la question.
On va donc expédier quelques faits qui devraient être des évidences depuis le temps : le marché japonais du jeu vidéo n’est jamais mort, contrairement à ce que suggérait Inafune (sa carrière par contre on peut pas en dire autant j’ai pas raison har har har) et ce que beaucoup trop de journalistes ont répété paresseusement. Il n’a même jamais été aussi lucratif que ces dernières années. Ce qui a décliné (avec l’économie globale du pays), c’est le marché de la console de salon au Japon, au profit du mobile et de l’arcade. La précision est cruciale, car elle nous permet de comprendre de quoi on parle réellement quand on parle de “déclin” du jeu japonais (le Reno Gazette Journal a même eu ce lapsus révélateur en 2014 : “le marché domestique [=japonais] s’est orienté dans la mauvaise direction”). Mais pour l’instant, ne nous embêtons pas avec des histoires de chiffres de vente. La vidéo de Game Next Door l’admet elle-même, en rappelant que les jeux japonais ne sont plus au sommet des charts mondiaux : “est-ce vraiment un problème ? je ne crois pas”. Sur ce point, nous sommes tout à fait d’accord ; c’est la qualité des jeux qui est intéressante.

Or là aussi, suggérer que la production japonaise sur consoles de salon est passée sous un tunnel pendant dix ans est une exagération. Certes, au cours de la 7e génération de consoles, la production occidentale a acquis un prestige qu’elle n’avait pas atteint auparavant sur ces machines-là, lesquelles étaient d’ailleurs, dans leur écrasante majorité, japonaises (Jeuxvideo.com, dans sa propre version du marronnier, s’en rappelle avec moult lyrisme). Mais ce n’est pas parce que les jeux de tir, les mondes ouverts et les jeux de tir en monde ouvert (et les indés) ont fait de l’ombre aux jeux japonais que ceux-ci étaient forcément négligeables.
Faut-il faire une liste ? Faisons une liste : plein de JRPG qui tentaient des trucs cools (Blue Dragon, Lost Odyssey, Resonance of Fate, Ni no Kuni, Xenoblade Chronicles), des épisodes de séries dont tout le monde parle aujourd’hui (Yakuza 3, Persona 4, NieR premier du nom, un certain jeu avec “Dark” dans le titre), des tauliers dans leurs genres biens spécifiques (Bayonetta, Street Fighter IV, Muramasa, Deathsmiles), des séries B décalées voire carrément punk (Dead Rising, Deadly Premonition, No More Heroes, Earth Defense Force, Catherine), et puis un peu tout ce qui porte le logo Nintendo forcément. C’est tout de même dommage de s’arrêter aux pétards mouillés de Capcom (saviez-vous que les Resident Evil les plus vendus sont le 5 et le 6 ? voilà pourquoi on ne va pas parler de chiffres de vente) ou aux accidents industriels qu’ont été Final Fantasy XIII et Metal Gear Solid 4 pour décréter qu’un pays tout entier s’est cassé la gueule. Tout ça pour dire que, si on estime dès lors que le jeu japonais n’est jamais vraiment mort, il paraît donc absurde de parler de sa résurrection. Ça nous épargnerait quelques embarras, comme lorsque Daniel Andreyev sort un hasardeux “À la génération PS3 (...) il n’y a pas de moment d’émotion purement japonais”, ou que The Verge se retrouve à citer Hatsune Miku Project Diva Future Tone parmi “les jeux les plus marquants de 2017, aussi bien commercialement qu’auprès de la critique”

En plus du très français Alone in the Dark, le premier Resident Evil s'inspirait aussi des films d'horreur occidentaux (source de l'image)
Mais derrière ces panneaux dans lesquels on a tôt fait de tomber se cache quelque chose de plus insidieux. On le sent poindre dans la vidéo de Game Next Door, à travers des tournures de phrase innocentes, telles que (l’emphase est de nous) “les outils occidentaux sont enfin intégrés dans les productions japonaises”, ou “ça y est, les japonais n’ont plus peur de nos ordis” : l’idée selon laquelle le jeu japonais serait sorti de sa “crise identitaire” en devenant plus occidental, donc moins japonais. Mais attention ! Pas en devenant complètement occidental, comme lorsque les gros éditeurs nippons envoyaient leurs licences se faire rebooter tant bien que mal en Occident ; mais en incorporant un peu de bon sens de chez nous, de “métissage créatif (...) dont le résultat est très positif”. Parce que voilà, comme l’explique Andreyev (qui, à sa décharge, paraît un peu pris au dépourvu), quand les Japonais ont vu Dark Souls, “ils se sont dit c’est quoi ce jeu d’occidental”, et “tout d’un coup, les gens sont se rendus compte que les jeux japonais, c’est pas juste des jeux de tir sur des lycéennes kawaï, des jeux de drague, ou même des yakuzas qui se baladent dans les rues de Shinjuku”. Avec une grille de lecture entachée de clichés pareils, on s’approche dangereusement des gauloiseries d’un certain youtubeur à chemise à fleurs. Va-t-on reprocher aux jeux japonais d’être trop japonais ? Alors que ce que l’on attend d’eux, précisément, c’est d’être “japonais” ? Sait-on seulement ce qui est “japonais” dans un jeu japonais ?
Eh bien, on ne sait pas tellement. Le corpus journalistique de la grandeur post-décadence du Japon est criblé de contradictions et d’hypothèses foireuses ; en le lisant, on comprend mieux d’où viennent les failles dans le raisonnement de la vidéo de Game Next Door. Ainsi, dans Le Monde, on suppose que “les jeux nippons misent sur un scénario important, mais qui inclut une structure de jeu linéaire et de nombreuses cinématiques”, alors que “les titres occidentaux seraient plus axés sur l'expérience de jeu (sic) et les mondes ouverts”. Ce qui expliquerait pourquoi, toujours selon Le Monde, Final Fantasy XIII a été taxé de long couloir par la critique occidentale en 2010. C’est à se demander pourquoi la critique n’en a pas profité pour crucifier Call of Duty et Uncharted sur ce même motif. À moins que la véritable raison pour laquelle Final Fantasy XIII a été critiqué en occident serait que celui-ci était moins... ouvert que ses prédécesseurs, pourtant japonais ? Mais ne nous a-t-on pas expliqué, chez Gamekult notamment, que le jeu japonais est porté par des “contraintes imposées, voire arbitraires”, que ce sont les “murs invisibles” de Nier Automata et “l’absence quasi-totale de voix” dans Breath of the Wild qui incarnent les “caractéristiques culturelles” que les Japonais assument de façon “orgueilleuse” ? Crie-t-on à l’orientalisme lorsque Batman n’est pas foutu d’enjamber un ruban de police ?
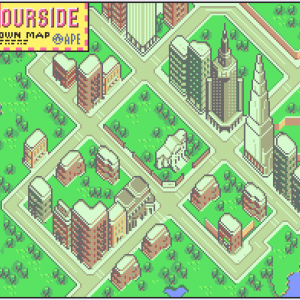
Et quand The Verge se risque à dire que contrairement aux jeux occidentaux “immersifs et spectaculaires”, les jeux japonais sont “mécaniques” et ont souvent “des menus complexes”, on a envie de répondre qu’Ico n’avait quasiment aucun affichage tête haute en 2001, mais on se rappelle alors que Fumito Ueda n’a jamais caché sa dette envers l’Another World d’Éric Chahi, puis on peut se dire que c’est vrai que Dan Houser considérait que sans Mario et Zelda 64 il n’aurait jamais fait GTA III, puis remarquer que Dragon Quest à la base c'est Wizardry, puis avant de régresser vers l’infini, on peut s’arrêter deux secondes et réaliser que la quête de la nipponité n’est pas aussi simple que ça.
Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il faut l’abandonner. Car si Game Next Door (et GK et JVcom etc.) se sont posés cette question, c’est bien parce qu’ils ont mis le doigt sur quelque chose. Quelque chose qui s’est exprimé également dans l’industrie japonaise pendant cette fameuse 7e génération “maudite”, quelque chose qu’on a eu tendance à assimiler à un complexe d’infériorité. Lorsque Capcom, notamment sous l’impulsion d’un certain Keiji Inafune, s’est lancé dans une politique intense de sous-traitance en Occident, aux résultats mitigés (et qui a failli culminer en un reboot de Mega Man développé au Texas) ; lorsque Square-Enix, ayant fraîchement racheté Eidos et son catalogue éminemment occidental, sort Nier en deux versions, une pour les Japonais et une pour les Occidentaux ; lorsque Grasshopper Manufacture s’est retrouvé à faire un jeu pour Electronic Arts, ces derniers se permettant de saboter son développement sous prétexte de le rendre plus attrayant aux “westerners” ; ou encore lorsque Sega a produit l’étrange Binary Domain, un jeu en apparence sans ambition, calqué sur les jeux de tirs à couverture qui étaient à la mode en son temps (et quasi-exclusivement occidentaux), mais qui raconte l’histoire d’un affrontement technologique entre… l’Occident et le Japon.
Lorsqu’en 2017 les journalistes demandent aux devs japonais les raisons de leurs récents triomphes, ces derniers semblent s’accorder à dire qu’ils ont tout simplement arrêté de se forcer à faire des jeux occidentaux. Toshihiro Nagoshi (le créateur de Yakuza - et également de Binary Domain) le dit tout de go : “nous ne prenons jamais en compte l’Occident quand nous faisons un nouveau Yakuza. C’est peut-être l’une des choses qui rend ces jeux particulièrement uniques”. Atsushi Inaba (Platinum) tente une métaphore intéressante, en comparant l’identité japonaise à de l’alcool que “si on dilue trop, ça devient de la flotte et ça n’a plus aucun intérêt”. Atsushi Hashimoto (Tokyo RPG Factory) emploie le mot d’“honnêteté” pour désigner l’aspect “authentiquement japonais” de ses œuvres ; juste à côté de cette citation, l’article de Gamekult parle de “déformation”. C’est pourtant dans ce même article que GK reconnaît que “c’est en cessant de vouloir être autre chose que lui-même que le jeu vidéo japonais est progressivement revenu”. Pourquoi est-ce si compliqué à admettre, alors ? Pourquoi l’article de Gamekult, citant un billet de Merlanfrit, se sent obligé de nous rappeler que le jeu japonais, c’est aussi “le gasha et ses dérivés, le jeu de drague libidineux, les séries déclinées jusqu’à la nausée”, les “cochonneries” qui font ricaner les spectateurs du Joueur du Grenier ? Ne faisons-nous pas nous aussi des “cochonneries”, en Occident ?
Si on galère à ce point à évoquer les jeux japonais sous l’angle de leurs origines, c’est peut-être parce qu’on n’en a pas l’habitude, parce que par défaut, tous les autres jeux sont “occidentaux”. Et que de manière générale, l’Occident de nos jours, c’est devenu le monde entier.

Le héros de la saga polonaise The Witcher apparaît dans deux jeux japonais en 2018 : Soul Calibur VI et Monster Hunter World (ci-dessus)
Une fois, je m’en rappellerai (de travers) toute ma vie, j’ai assisté à une table ronde de devs indés français, en 2014 à Paris. Après quelques minutes à peine, l’animateur de la table ronde demande aux devs, en termes peut-être maladroits, s’il est permis de parler d’une scène “française” du jeu indé, une sorte de “french touch” comme il peut exister un “jeu japonais” en fin de compte. Les devs réagissent violemment. L’un d’entre eux trouve que ça fait “débat sur l’identité nationale” (pour rappel, il s’agissait d’une initiative lancée en 2009 par le président de la République et consistant à solliciter la population afin de trouver des manières créatives de dire du mal des Arabes). Un autre vitupère que ce n’est pas parce qu’il est indé qu’il doit se plier aux injonctions à faire de la culture, qu’il n’a pas à foutre Gérard Depardieu ou des baguettes de pain dans son jeu pour faire plaisir aux bobos, et que de toute façon son objectif c’est de remplir la voiture de gazole, donc de faire un jeu qui se vend, donc de faire un jeu pas français. Un autre mec dira plus tard dans cette table ronde qu’il ne fait pas du jeu vidéo pour faire des œuvres personnelles, parce que s’il devait faire un jeu personnel, il ferait simplement son jeu préféré, or son jeu préféré est déjà sorti en 1998 et s’appelle Metal Slug 2, donc ça n’a aucun intérêt il ne va tout de même pas refaire Metal Slug 2, et même si cela n’a pas de rapport avec le sujet de cet article (quoique…), je pense toujours très fort à ce qu’a dit ce monsieur.
Il y a tout de même deux choses à retirer de cette anecdote : la première, c’est qu’on n’en sait manifestement pas davantage sur la “francité” d’un jeu vidéo que sur sa “nipponité” (pour rappel : c’est dans un jeu japonais que Jean Reno incarne un personnage jouable, et l’histoire ne dit pas si seuls des bobos sont allés l’acheter). La deuxième, c’est que le dev qui roule au gazole a raison : pour se vendre au maximum, un jeu vidéo doit parler à un maximum de monde. C’est ce que rappelle Martin Picard, chercheur à l’institut est-asiatique de l’université de Leipzig, en préambule d’une étude publiée dans la revue Game Studies en 2013 : “Les jeux vidéo japonais, ou geemu [anglicisme désignant les jeux vidéo dans la langue japonaise] ne sont pas liés à une ‘essence’ d’une quelconque sorte (nationale, médiatique, etc.), mais à un marché, ou plutôt à plusieurs marchés -- certes instables et fluctuants”. C’est cet assujettissement au marché qui façonne les jeux ; du moins, ceux que relaient les journalistes avec le plus d’enthousiasme. Et le marché du jeu vidéo, devenu global (c’est à dire occidental) comme les autres, génère principalement une culture globale. Forcément, en observant le monde à travers cette culture globale, tout ce qui diverge du trait dominant va avoir tendance à échapper à notre grille de lecture, exactement comme le font les jeux japonais. Voilà peut-être pourquoi les journalistes s’évertuent à vouloir les étiqueter ; sans doute recherchent-ils dans les jeux faits au Japon quelque chose qu’ils ne trouvent pas ailleurs, une alternative à la production occidentalisée, pour reprendre le mot qu’emploient chacun de leur côté les papiers de Gamekult et Merlanfrit. Ce dernier qui non seulement cite l’étude de Martin Picard, mais qui surtout est signé Martin Lefebvre, qui était l’animateur de la table ronde des indés français sus-évoquée.
Ce que fait Lefebvre ici, en fin de compte, c’est souligner que dans des circonstances différentes - un autre pays, un autre marché, une autre histoire - surgit une culture différente. Dans le jeu vidéo plus qu’ailleurs, on a pu ressentir cette différence, celle dont Jeuxvideo.com parle avec tant de nostalgie, et que Merlanfrit considère comme “une partie de notre identité” ; pendant longtemps, l’Occident n’a pas été le monde entier du JV. À présent, cette différence japonaise sur laquelle on peine tant à mettre des mots est l’alternative, le “modèle hétérodoxe”, et il va de soi qu’il faut la défendre, dans un monde où l’histoire est écrite par ceux qui ont le plus gros budget marketing, et où les devs indés ne voient pas forcément pourquoi mettre Gérard Depardieu dans un jeu vidéo pourrait tout à fait être une excellente idée (le mot-clé étant “pourrait”). On ne parlerait peut-être pas autant de “déclin” du jeu japonais si nous avions su nous montrer plus attentifs, et ne pas réserver l’analyse culturelle aux marronniers “business” où il est trop facile de verser dans l’essentialisme.

Finir Neo Contra avec le rang S débloque cette vidéo. Selon Tim Rogers, "C'est pour ça qu'une équipe américaine a été appelée pour s'occuper de Contra 4 — pour que ce conte éternel d'hommes torses nus avec des grosses mitraillettes reste aussi hétérosexuel que possible."
Ce travail d’analyse, on peut le trouver dans les critiques de feu Actionbutton.net, l’ancien site de Tim Rogers qui était à l’époque basé au Japon, et particulièrement actif pendant la septième génération. On peut le trouver dans les excellents billets de La faute à la manette qui redonnent leur contexte aux tropes des classiques du jeu nippon. Plus récemment, on le retrouve dans cet article du Pixel Post qui décrit comment l’âge d’or du Shibuya-kei a façonné les tubes des années Dreamcast. Et enfin, on le trouve dans le billet de Merlanfrit (qui cite Jun’ichiro Tanizaki comme on pourrait citer l’afro-futurisme de Black Panther), mais aussi dans les Kyoto Stories réalisées par Victor Moisan, l’auteur de l’article de GK susmentionné. Et puis dans les revues académiques de game studies (tenez, un exemple au hasard), sur les wikis comme TV Tropes ou The Cutting Room Floor qui listent les différences entre les versions locales de tel ou tel jeu, le site Legends of Localization consacré à la traduction depuis et vers le japonais, ou sur les sites de patrimoine comme Hardcore Gaming 101 ou Grospixels. On pourrait vous parler des aventures de Rami Ismaïl, qui voyage sans cesse à la rencontre des indés de tout pays (il nous en a parlé vite fait ici), ou d’Isabelle Arvers, qui s’est récemment lancée dans un “tour du monde art et jeu vidéo” (on vous parlait d’elle vite fait ici), ou de Sos Sosovski qui prétend reconnaître le pays d’origine d’un jeu vidéo juste en regardant à quoi ressemblent ses chiottes… ou alors on pourrait, nous les premiers, développer une critique vidéoludique davantage curieuse du contexte, qui renseigne mieux sur la provenance des jeux, et pas seulement géographique. Même si, en l'occurrence, le Japon est un exemple fort bien documenté de conjonction entre unités territoriale et culturelle, en tant que pays insulaire et longtemps isolé du reste du monde, mais ça vous le savez déjà bande de weebs, pas vrai ?
Aujourd’hui, avec la disparition quasi-totale du zonage et la présence accrue de jeux japonais traduits sur les magasins occidentaux, nous avons de moins en moins d’excuses pour ne pas parler du jeu japonais tel qu’il est réellement, sans s’arrêter aux AAA ou aux “cochonneries” racoleuses. Il y a un peu plus d’un mois à Kyoto, juste avant l’E3 avait lieu le Bitsummit, le salon du jeu indé japonais, “la plus grosse édition” de son histoire d’après Kotaku ; et en septembre se tiendra le Tokyo Games Show, où l’an dernier nous avaient été montrés Death Stranding, Resident Evil 2 et Devil May Cry 5. On n’a plus qu’à espérer que désormais, on ne parlera plus du jeu japonais comme d’un revenant.
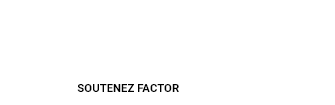
Commentaires